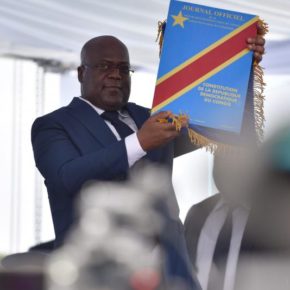Par Jean-Pierre Mbelu
Pour éviter de s’empoigner, disait quelqu’un, il faut commencer par donner aux mots leur sens. Souvent, ils en ont plusieurs. Ils sont polysémiques. Que peut bien signifier un paradigme ?
Un paradigme me semble être un ensemble d’idées marquant (et dominant) les cœurs et les esprits et orientant l’imaginaire d’un groupe d’individu, d’une nation, d’un pays ou du monde pour une période donnée. Souvent, les paradigmes dominants cherchent à imposer la manière de voir les choses de ceux qui les ont produits et/ou de leurs experts.
Ces idées peuvent constituer une certaine vision du monde portée par une matrice organisationnelle. Et à différentes périodes de l’histoire tout comme en politique, il y a des paradigmes dominants.
Paradigmes d’indignité
Les théories racialistes, par exemple, ont produit un « paradigme de néantisation » du « nègre » fondé sur son inférioriorisation dans la hiérarchisation des races et justifiant son exploitation pendant toute la période de la traite négrière. Le nègre étant perçu comme moins que rien, étant néantisé,perçu comme n’ayant pas d’ âme, pouvait être exploitée comme une bête de somme. (La tendance à se percevoir comme l’autre le perçoit ne semble pas avoir disparu. Il participe du viol de son imaginaire le conduisant à se percevoir comme étant une « non personne ».)
Les théories racialistes, par exemple, ont produit un « paradigme de néantisation » du « nègre » fondé sur son inférioriorisation dans la hiérarchisation des races et justifiant son exploitation pendant toute la période de la traite négrière.
Au Congo-Kinshasa, il a produit du caoutchouc pour la métropole. Et quand il ne pouvait pas fournir la quantité exigée, ses mains étaient coupées. Donc, les théories racialistes ont organisé des idées dominantes de l’exploitation du « nègre ». Et cela a duré (et dure encore?) jusqu’à l’époque coloniale. Celle-ci a fonctionné sur fond du « paradigme de l’indignité ». Reconnu comme humain, quand même, « le nègre » a été traité comme un humain indigne de son humanité. De la part du colon, il a l’objet des passions tristes telles que la haine, la violence, le mépris, etc.
Ces passions tristes ont contribué à « la décivilisation » réciproque et du « nègre » et du « colon », à la perte des « valeurs bu BOMOTO » (la justice, la vérité, la dignité, la liberté, etc.) (« Le discours sur le colonialisme » d’Aimé Césaire décrit merveilleusement bien cette situation. Notre livre, « A quand le Congo« (2016) y revient). Au Congo-Kinshasa, les luttes menées pour l’indépendance avaient, entre autres, pour objectif de remplacer ce paradigme de l’indignité par celui de la dignité et de la solidarité.
Pour autre paradigme pour le Congo-Kinshasa de demain
Les manifestes de la Conscience Africaine et de l’ABAKO en portaient la matrice organisationnelle. La victoire des « partis nationalistes » aux élections de 1960 en était un premier signe. Hélas ! Le néocolonialisme est venu tout balayer sur son passage et semble reconduire, pour longtemps les deux paradigmes négatifs susmentionnés.
Le néocolonialisme inauguré par l’assassinat de plusieurs Pères et Mères de l’indépendance du pays a inoculé dans les cœurs et les esprits de plusieurs compatriotes une peur existentielle. La peur de subir le même sort que les Pères et les Mères de l’indépendance.
Ce néocolonialisme inauguré par l’assassinat de plusieurs Pères et Mères de l’indépendance du pays a inoculé dans les cœurs et les esprits de plusieurs compatriotes une peur existentielle. La peur de subir le même sort que les Pères et les Mères de l’indépendance. Les politiciens et les autres élites compradores (et/ou agents de l’étranger) ont cultivé cette peur dans les cœurs et les esprits des masses populaires, les ont habituées aux slogans sans réalisations concrètes et au culte de la personnalité.
Agents de l’étranger, ils n’ont pas pu créer un nouveau paradigme politique. « La remise en question » de Mabika Kalanda ne les a pas secoués. Ils ont, pour la plupart, étaient les chantres du néocolonialisme et du néolibéralisme.
Un autre paradigme pour le Congo-Kinshasa de demain comprendrait des idées ayant permis aux Pères et Mères de l’indépendance de résister contre les paradigmes négatifs de néantisation et d’indignité, celles leur ayant permis d’accéder à notre indépendance formelle et celles ayant soutenu les luttes des masses populaires au cours de la période néocoloniale et néolibérale.
Le Congo-Kinshasa a besoin d’être pensé et repensé
Cela suppose une bonne identification de l’adversaire et des moyens matériels, intellectuels, spirituels, économiques, sécuritaires, culturels et religieux auxquels il recourt pour dominer et maintenir son hégémonie. Cela suppose que les mêmes moyens soient mobilisés par la descendance de Kimpa Vita, Kimbangu, Kasavubu, Lumumba, Mpolo, Okito, etc. pour renverser le rapport de force et refonder un « Etat régulateur, tuteur et éducateur de la nation ».
La Résistance Participative et de la Solidarité, congolaise, pourrait avoir comme matrice organisationnelle les idées de coopération (coopérative), de fraternité et d’intersocialité et de toutes les autres valeurs du « BOMOTO ».
A mon avis, ce paradigme ne peut être que celui de la Résistance Participative et de la Solidarité. Il pourrait avoir comme matrice organisationnelle les idées de coopération (coopérative), de fraternité et d’intersocialité et de toutes les autres valeurs du « BOMOTO ». Il serait porté par un groupe de leaders, par un leadership collectif, jouant au sein des masses populaires auto-organisées (en un grand mouvement populaire) le rôle du levain dans la pâte, le rôle d' »intellectuels organiques », en partant du village, de la base.
Ce mouvement serait composé de collectifs citoyens interconnectés en fonction de leurs centres d’intérêts et de leur contribution à l’intérêt général. Il aurait plusieurs composantes en son sein et vivrait du débat, de la délibération et de la participation de tous aux décisions collectives.
Le point de départ serait, à mon avis, des rencontres (suivies et évaluées) entre filles et fils du pays décidé(e)s à procéder à la mise sur pied d’une Ethique reconstructive du pays et refondatrice de l’Etat en se posant des questions du genre : »D’où venons-nous ? Où en sommes-nous ? Où allons-nous ? Quelles ont été nos responsabilités dans tout ce qui nous est arrivé ? Comment réparer pour aller de l’avant en entretenant lucidement et consciencieusement notre mémoire collective.
Le Congo-Kinshasa a besoin d’être pensé et repensé. A temps et à contretemps.
Babanya Kabudi
Génération Lumumba 1961